
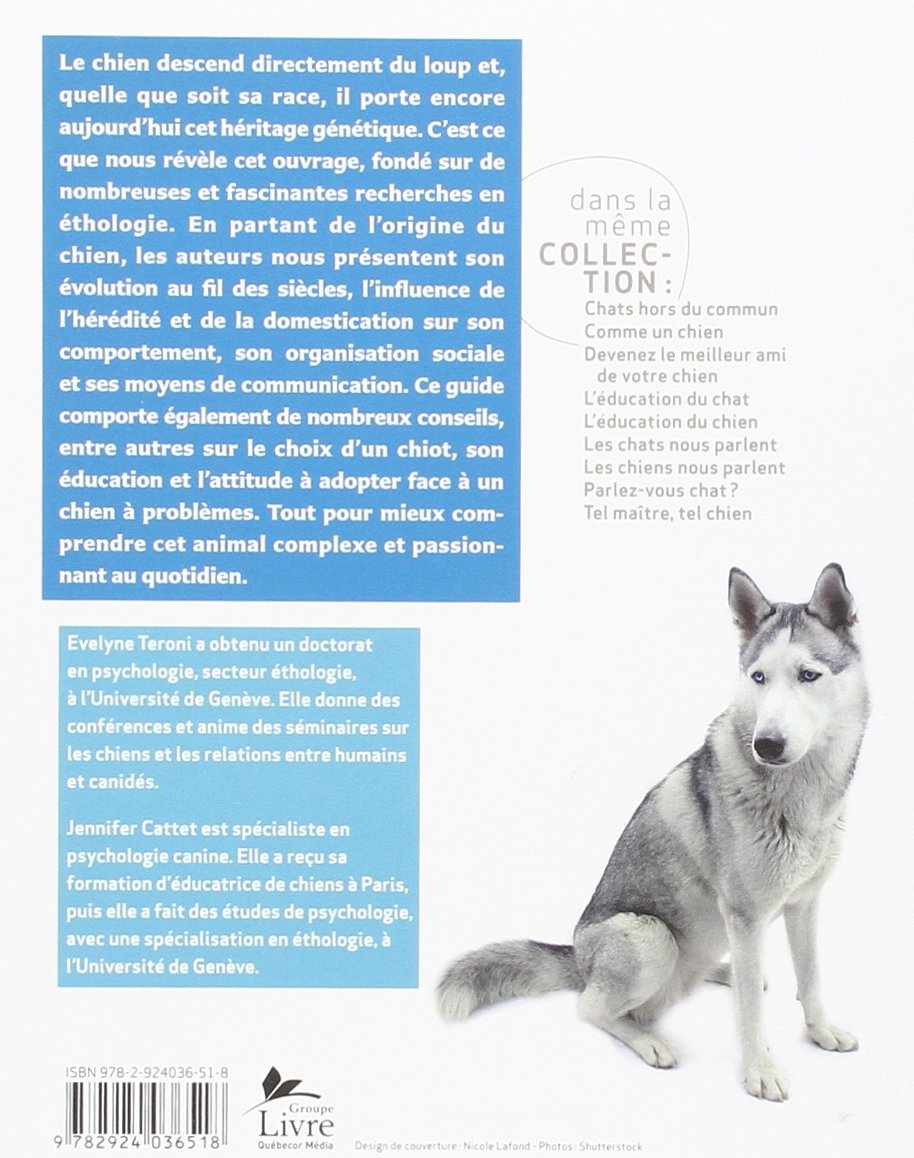
Introduction
Auteur : Evelyne TERONI et Jennifer CATTET
Édition : La griffe
Date : 2004
Nombre de pages : 256
ISBN : 9782761926430
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui aiment les chiens, les gens qui travaillent avec ces animaux (vétérinaire, éducateurs, éleveurs ou juges), mais également aux simples maîtres qui cherchent à mieux comprendre leur animal, aux individus qui désirent en adopter un et aux curieux qui se posent mille questions sur ces animaux fascinants.
Quant aux spécialistes, ils trouveront leur compte dans la bibliographie exhaustive et ses +450 références.
Les auteurs
Evelyne TERONI a une formation en psychologie humaine et a obtenu un doctorat à l’Université de Genève en psychologie, section éthologie. Elle a été assistante pendant 5 ans dans cette même section.
Elle travaille actuellement en tant que comportementaliste à Genève. Elle a tenu des rubriques dans différents journaux consacrés aux chiens.
Elle donne régulièrement des conférences sur divers aspects du comportement des chiens ainsi que sur la relation entre humains et chiens.
Pour contacter Évelyne Teroni par courrier électronique :
Jennifer CATTET est éthologue, diplômée de l’Université de Genève ou elle a travaillé en tant qu’assistante pendant six ans. Elle a développé la première école professionnelle d’éducation canine par le Clicker-Training en France.
Elle a participé à différentes émissions de radio et de télévision ainsi qu’à plusieurs articles dans des revues spécialisées.
Elle a écrit également un livre sur l’orientation spatiale chez les chiens.
Pour contacter Jennifer Cattet par courrier électronique :
Notes de lecture
Le livre commence sur une citation :
Posséder un chien n’est pas un droit, mais un privilège : à nous de le mériter
D’après des fossiles, des chercheurs ont établi que le chien partageait l’existence des hommes il y a près de 12 000 ans voire 14 000. Des ossements de chiens ont également été retrouvés auprès d’humains dans d’autres sites archéologiques. Les premiers fossiles suggèrent que la domestication du chien a eu lieu où l’homme du pléistocène est passé d’un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire.
Parmi les 38 espèces originelles, seuls trois sont particulièrement proches du chien d’un point de vue morphologique : les coyotes (canis latrans), les chacals (canis aureus) et les loups (canis lupus).
Quand on compare les analyses de séquence ADN de ces trois espèces, il en ressort que le chien est plus proche du loup, c’est également le constat qui est fait d’un point de vue comportementale.
De nombreux vestiges prouvent que déjà certaines races de chiens étaient sélectionnées pour des tâches précises, par les Égyptiens ainsi que les Romains.
Les auteurs insistent sur l’importance de la notion de hiérarchie sociale, et l’importance de la réhabiliter si l’on veut améliorer les relations sociales entre l’homme et le chien. Ils reviennent donc sur les études effectuées sur les loups et les dingos, mais également sur les différentes positions dans la hiérarchie (Alpha…)
Par ailleurs, on y apprend que de nombreux auteurs insistent sur l’importance des premiers mois de vie du chiot qui imprègnent le chien et peuvent être plus forts que les caractères innés.
Les auteurs divisent le développement du chiot en 7 stades :
- Stade 1 : La période prénatale
- Stade 2 : La période néonatale
- Stade 3 : La période de transition
- Stade 4 : La période de sociabilisation
- Stade 5 : La prépuberté
- Stade 6 : La puberté
- Stade 7 : L’âge adulte
Stade 1 – prénatal
Au cours du premier stade, il apparait que le stress provoque des modifications hormonales chez la chienne en gestation, qui semblent avoir des effets à long terme sur les réponses physiologiques des chiots ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage et leurs réactions face à la nouveauté.
Stade 2 – 0 à 14 jours
Le Stade 2, de la naissance à 2 semaines, marque une période végétative qui est en quelque sorte le prolongement de la vie intra-utérine. Les chiots n’ont pas encore un système nerveux totalement développé et leur cortex cérébral est pratiquement inexistant.
Le chiot se déplace dans un premier temps en rampant, c’est seulement vers le 10ème jour qu’il commence à utiliser ses pattes antérieurs tout en traînant son arrière-train. Les pattes postérieures entrent en action vers le 15ème jour.
Les chiots naissent sourds et aveugles, leurs yeux ne s’ouvrent qu’aux alentours du 14ème jour et la plupart d’entre eux ne réagissent pas aux sons avant le 19ème jour.
D’ailleurs la mère ne communique pas par des sons avec ses petits durant leurs premières semaines de vie.
Durant cette période, le chiot dépend entièrement de sa mère et il dort 90% du temps. C’est elle qui par le léchage va stimuler l’élimination des urines et matières fécales, et qui jusqu’à 3 semaines maintient la propreté de la couche en ingérant les éliminations.
Les nouveaux-nés ne peuvent pas maintenir leur température corporelle quand la température ambiante est inférieure à 6°C ou supérieure à 40°C. Ils commencent à vocaliser peu de temps après la naissance, de façon générale.
Stade 3 – 14 à 21 jours
Les sens se développent peu à peu lors de cette période, avec l’amélioration de l’audition autour du 19ème jour.
Le sommeil des chiots diminuent pour laisser la place à un éveil plus long. De plus le sommeil lui-même évolue, les phases de sommeil paradoxal diminuent pour laisser place à des phases de sommeil calme.
Le chiot n’a plus besoin des léchages de sa mère et préfère généralement s’éloigner du « nid » pour faire ses besoins.
Les premières dents de lait apparaissent à ce stade, et les chiots se mettent à manger de la nourriture solide vers le 18ème jour.
Les premières interactions actives dans la fratrie apparaissent, ainsi que les premiers léchages réciproques et les premiers jeux.
Stade 4 – 21 jours à 10-12 semaines
Le chiot devient suffisamment agile pour courir, sauter et garder son équilibre. A cet âge l’exploration buccale est intense, les petits font connaissances avec les objets en les mordillant.
généralement, les premiers aboiement retentissent entre le 20ème et le 24ème jour au cours des jeux.
La socialisation intraspécifique, correspond à l’imprégnation du chiot avec ses congénères, est essentiel d’une part pour que le chien apprenne à modérer la pression de sa mâchoire lors des jeux (« inhibition de la morsure »), et d’autre part afin d’être exposé à différentes races de chiens pour ne pas développer de réticence à certains morphotypes (oreilles tombantes, nez écrasé…).
La socialisation interspécifique, quant à elle correspond à la familiarisation du chiot avec des humains (enfants, adultes…) et tout autre race d’animaux que le chien (poules, chats…). D’une même manière que pour la socialisation intraspécifique, si le chiot n’est en contact qu’avec un certain type d’humain, celui-ci risque d’éprouver une certaine crainte à l’égard d’autres personnes.
Lors de ce stade, l’acquisition de la notion de hiérarchie se fait dans un premier temps à travers la relation chiot-mère et avec ses frères et sœurs (souvent corrélé au poids du chiot), pour ensuite s’étendre aux membres de la famille humaine dans laquelle il vivra.
A partir de la 3ème ou 4ème semaine, la plupart des chiennes se montrent moins tolérantes lors des tétées. Le sevrage proprement dit peut commencer entre la 4ème et la 7ème semaine, selon les mères.
Stade 5 – 10-12 semaines à la maturité sexuelle
Les comportements des chiots ne changent pas significativement, mais les chiots deviennent plus adroits dans leurs mouvements.
Stade 6 – puberté
Chez les femelles la puberté apparait généralement vers 10 – 12 mois de manière soudaine avec les premières chaleurs, tandis que chez les mâles elle se fait de façon plus progressive associée à une augmentation du niveau de testostérone.
Cette période est difficile pour les propriétaires et pour les chiens, qui cherchent leur place. Les chiens ont tendance à s’enfuir et à ne plus obéir.
Stade 7 – l’âge adulte
Au cours de ce stade, généralement vers 18 – 36 mois, le chien atteint sa maturité sociale.
Il est bon de rappeler que le chien est un animal unique dont le comportement est influencé d’une part par l’hérédité et d’autre part par l’expérience depuis le jour de la naissance, et même durant la période de gestation.
Intéressons-nous désormais aux études réalisées sur les différents sens du chien, que sont :
– la vision
– l’audition
– l’olfaction
– le toucher
– le goût
La vision
Les études réalisées sur les canidés ont mis en évidence le rôle essentiel de la vision, étant donné que la majorité des communications proches se font à travers des mimiques (ouverture plus ou moins importante de la gueule, modification de la pupille…).
On oublie souvent que les chiens étant plus petits, ils ne voient pas le monde sous la même perspective.
Les chiens peuvent modifier la forme de leur cristallin, de la même manière que l’homme, mais leur accommodation n’est pas aussi fine que la notre.
Leur champ visuel est plus étendu que celui de l’homme, de 250 à 280° pour le chien (plus élevé pour un chien au museau allongé) contre 180° pour l’homme.
Cependant leur vision binoculaire est plus faible, 80° à 100° pour le chien contre 130° pour l’homme.
Le chien peine à voir un objet immobile sous son nez, mais il excelle quand il s’agit de repérer un mouvement sur de grandes distances.
Pleins de théories diverses sont sorties concernant la vision des chiens, de la vision de couleur à celle en noir et blanc, en passant par la vision de couleurs privilégiées.
Il faut savoir que la rétine possède 2 types de photorécepteurs :
– les cônes, qui sont responsables de la vision en couleur
– les bâtonnets, qui sont sensibles à des faisceaux lumineux très faibles et ne décèlent que le noir et blanc
Chez le chien, le pourcentage de cônes est moins élevé que dans l’œil humain, cela entraîne donc une vision des couleurs moins évidente pour le chien.
De plus, il existe différents types de cônes chaque type étant sensible à une couleur. Le chien n’en possédant que deux (bleu et vert), il est dit bichromatique, tandis que l’homme en possède trois (rouge, bleu et vert). Le chien n’a donc pas la capacité de voir les couleurs jaunes, oranges, rouges.
La vision nocturne qu’on attribue au chien n’est pas bien définit, il est connu que les pupilles des chiens ont la capacité de se dilater beaucoup plus que celles des humains et qu’ils possèdent de nombreux bâtonnets.
De plus le fond de leur œil est recouvert d’une couche de cellules réfléchissantes (tapetum lucidum), absente chez l’Homme. C’est le tapetum lucidum qui fait briller les yeux des chiens (et de bien d’autres animaux) lorsqu’on les éclaire la nuit.
Les chiens on une plus grande vitesse de réaction en comparaison aux humains, cela a été appuyé par des expériences démontrant qu’ils peuvent distinguer jusqu’à 90 flash lumineux par seconde.
L’audition
Chez le chien, une plus grande partie du cerveau est dédiée à l’audition, comparé à l’Homme. De plus leurs oreilles mobiles et indépendantes leurs permettent d’être à l’écoute de leur environnement sans devoir bouger la tête et de distinguer la provenance d’un son avec une grande précision.
Les chiens aux oreilles dressées sont avantagées, car leurs pavillons agissent comme des amplificateurs.
Une étude a montré que le chien serait capable de localiser la source d’un son en 6 millièmes de seconde !
En terme de plage de fréquence audible par le chien, il nous surpasse de beaucoup pour la perception des sons aigus. Alors que la limite humaine supérieure est de 20 000 kHz, le chien peut capter des sons allant jusqu’à 45 000 kHz. Tandis que pour les sons de basse fréquence, l’Homme et le chien possèdent des facultés similaires (10 Hz pour le chien, 20 Hz pour l’Homme).
Selon une étude, un hurlement de loup peut être détecté par son congénère à 6 km de distance !
L’olfaction
La plupart des chiens présentent un développement de la muqueuse qui tapisse l’intérieur du nez ce qui en augmente la surface. Quelques chiffres :
– 200 millions de cellules olfactives pour le Berger Allemand
– 147 millions pour un Fox
– 225 millions pour un Labrador
– 10 millions pour l’Homme
L’odorat des chiens est capable de prouesses tels que la recherche de personnes ensevelies sous une avalanche ou des décombres, la détection de drogues ou d’explosifs, la découverte de truffes, la détection de certaines maladies, l’anticipation de crises d’épilepsie, repérer les cellules cancéreuses… et même la capacité de reconnaitre les vaches en œstrus et les séparer d’un troupeau !
Un chien peut détecter un nombre infinis d’odeurs même si elles sont fortement diluées, et à des seuils de perception incroyables.
Par exemple, le seuil de détection du chien est :
– 108 fois inférieur à celui de l’Homme pour l’acide acétique (constituant des sécrétions de la peau humaine)
– 1 000 à 10 000 fois inférieur pour l’ionone (molécule utilisé en parfumerie), chez le berger allemand
– 1 000 000 fois inférieur pour l’acide n-butyrique (composant de la transpiration)
Quant aux dilutions, le chien retrouve la trace :
– de l’acide acétique, même s’il est dilué 1 000 000 de fois (équivalent à percevoir une goutte de vinaigre dans 50l d’eau)
– de l’acide sulfurique, avec un taux de dilution 10 fois supérieur
Afin de suivre une piste odorante, le chien s’oriente e n fonction d’un gradient odorant. Il peut retrouver la source odorante en fonction du décalage qu’il perçoit entre sa narine droite et sa narine gauche.
Le toucher, la réception de la température et de la douleur
Durant les premières semaines de leur développement, les chiots restent groupés. Lorsqu’ils se trouvent éloignés de leurs frères et sœurs, ils cherchent à les rejoindre.
Puis petit à petit, ils prennent de la distance mais l’importance du toucher se prolonge tout au long de leur existence.
Le toucher est pour les chiens un moyen de communication, en se donnant des coups de patte, en se léchant etc. C’est également un moyen pour indiquer leur position hiérarchique, par exemple le dominant pose sa patte ou sa tête sur le cou du dominé, ou bien saisit le museau du dominé dans sa gueule.
D’un point de vue anatomique, la peau du chien contient des récepteurs sensoriels et des vibrisses qui sont des poils sensoriels se trouvant en grand nombre sur le museau, au-dessus des yeux ainsi que sous les mâchoires.
Il a été observé lors d’études, que le chien reçoit d’une caresse un bienfait comparable à celui obtenu par l’Humain qui le caresse. C’est-à-dire une diminution du rythme cardiaque et de la pression sanguine ainsi qu’une sensation de calme.
Le goût
Les chiens possèdent beaucoup moins de papilles gustatives que les humains (2 000 contre 10 000), ils sont donc moins « gourmets ».
Le livre s’intéresse également aux différentes formes de communication chez le chien, voyons cela.
La communication
Chez l’animal comme chez l’Homme, l’usage de la communication non verbale est essentiel, le corps reflète les intentions et les états émotionnels. Même si chez le chien, le corps tout entier est source d’expression, la queue, les oreilles, la face, les yeux et son corps lui permettent d’exprimer ses émotions et ses intentions.
Pour appuyer le « langage » du corps, les chiens usent également d’un vaste répertoire de sons, grognements, hurlements, aboiements ou de gémissements.
Quand on cherche à savoir « de quoi parle les chiens ? », on peut regrouper les principaux sujets d’expression en trois groupes :
– les relations sociales (salutations, dominance, menace, soumission…)
– les états affectifs (peur, excitation, joie, intérêt…)
– les besoins et désirs (jeu, attention…)
Les relations sociales
Lorsque deux chiens se rencontrent ils vont se saluer, s’ils s’ont animés de bonnes intentions. Ces comportements ritualisés, visant à neutraliser les possibilités d’agression, incluent toutes sortes de comportements tels que : s’approcher en se contournant, s’immobiliser, se renifler les oreilles, le museau, l’arrière-train (le plus sûr des deux lève la queue). Dans le cas où l’un des chiens n’adopte pas les codes de la salutation, les deux vont basculer sur les comportements de dominance/soumission afin d’établir leur rang respectif.
L’animal dominant va chercher à se faire plus grand, la tête haute, les oreilles dressées, la queue relevée. Pour intimider l’autre chien il va le fixer du regard, uriner puis gratter le sol bruyamment.
La soumission se traduit chez le chien par le détournement, les oreilles rabattues, il peut également ramper sur le ventre en agitant la queue et en effectuant des mouvements de langue comme pour lécher.
S’il est fortement réprimandé, il peut lever une patte avant et se pencher pour indiquer sa volonté de rouler sur le dos, sa queue est maintenue entre ses pattes postérieures.
Le marquage est un comportement essentiellement adopté par les mâles, que l’on observe quand ils lèvent la patte, urinent et grattent le sol (afin de déposer l’odeur des glandes interdigitales et faciliter la visualisation de la marque par ses congénères).
Les états affectifs
La peur se traduit par la salivation, la tête baisse, les oreilles rabattues en arrière, la queue entre les pattes et parfois par le fait d’uriner.
L’intérêt se manifeste lorsque le chien incline la tête sur le côté, la gueule détendue et entrouverte, les oreilles dressées et pointées vers l’avant, la queue est tenue presque à l’horizontal sans raideur.
L’excitation est visible chez le chien par les bonds qu’il peut faire, les battements vigoureux de sa queue.
lorsqu’il est excité et joyeux, il peut accompagnée ses mouvements d’une expression faciale joueuse (gueule entrouverte et halètements).
Le contentement pour un chien se traduit par un certain type de grondement, différent de celui de menace, parfois émis lorsque le chien éprouve un soulagement, lorsque son maitre le caresse etc.
Les besoins et les désirs
La sollicitation au jeu se traduit par les oreilles tournées vers l’avant, le chien halète d’excitation tout en agitant sa queue dans une position haute. l’avant-train touche le sol, tel une révérence. Il peut également lever alternativement les pattes avant, simulant une approche avec exagération.
Il peut également bondir en avant, feindre une morsure ou donner un coup de museau afin d’inciter à ce qu’on le poursuivre,.
La recherche d’attention peut se manifester par une multitude de comportements, ceux qui seront les plus utilisés par le chien seront ceux qui marchent le mieux pour attirer votre attention ! L’aboiement en est un parmi d’autre.
L’apprentissage
Le livre nous apprend qu’il existe plusieurs types d’apprentissage, que nous allons parcourir ci-dessous.
L’apprentissage par imitation
Il s’observe principalement chez les jeunes chiens, qui n’ont pas encore développé leur « personnalité », ils ont tendances à imiter leurs congénères (ex : si l’un d’eux se met à courir, il le suivra). Le chiot sera également influencé par le comportement de sa mère.
Il est à noter que la plupart des cas observés relève plutôt de la transmission d’un état émotionnel d’un individu à l’autre, plutôt que d’une vraie imitation.
L’apprentissage par accoutumance
Aussi appelé « apprentissage par habituation », il se caractérise par la disparition de la réponse motrice non apprise à un stimulus donné après que l’animal a été de façon répétée mis en présence du stimulus sans que ce dernier ait été associé ou renforcé par une stimulation favorable ou défavorable.
Prenons un cas d’exemple : au début de son séjour dans sa nouvelle demeure, un chien allait se réfugiait dans sa niche à chaque fois qu’un avion survolait le jardin, puisqu’un aéroport jouxte la propriété. Au bout de quelque semaines, ce comportement a disparu et le chien s’est habitué.
L’apprentissage pavlovien
Plus couramment appelé « conditionnement classique » ou « apprentissage par associations », il se définit par l’association d’un stimulus neutre à un stimulus familier et le déclenchement d’un comportement chez le chien.
Cet apprentissage porte le nom du physiologiste russe Ivan Pavlov qui a découvert qu’en faisant précéder l’apparition de la nourriture par un stimulus qui n’a aucune signification pour l’animal, par exemple le son d’une cloche, le chien se mettra peu à peu à saliver dès que le stimulus apparaitra, et ce, même en l’absence de nourriture.
L’apprentissage par essais/erreurs
Plus couramment appelé « conditionnement opérant » ou « conditionnement instrumental », il est caractérisé par le fait que l’animal sélectionne, parmi les opérations qu’il effectue spontanément et au hasard dans son environnement, celles qui lui sont favorables. Il apprend donc une réponse. Dans le cas contraire où son action est suivie d’une nuisance/punition, la probabilité de recommencer décroit.
Ce type de conditionnement a longtemps été étudié par Burrhus Frederic Skinner, qui a fait l’expérience suivante : Des rats été placés dans une cage contenant divers objets, parmi lesquels un levier qu’il suffisait d’actionner pour obtenir de la nourriture. Le rat comment à explorer son environnement et, par hasard, active le levier et reçoit une croquette, ce qui au fur et à mesure, provoqua chez le rat d’activer le levier de plus en plus rapidement et fréquemment.
De nombreux comportements canins sont conditionnés de la sorte par les humains, souvent à leur insu, par le biais de renforcements, de déconditionnement ou de punitions.
Le renforcement :
Lorsque le comportement du chien est suivi d’effets favorables, il se trouve renforcée soit positivement (récompense) soit négativement (cessation ou non-apparition d’un stimulus désagréable)
Au cours de nombreuses études, il a été démontré que les animaux apprennent plus vite et avec plus d’entrain, lorsque des récompenses alimentaires sont associées aux récompenses verbales, surtout durant la phase initiale du processus d’apprentissage.
Au début du processus, la réponse désirée doit être renforcée immédiatemment et systématiquement. Puis une fois installé, le renforcement peut devenir intermittent et légèrement différé.
Il est à noter, que le renforcement peut être involontaire, les exemples ne manquent pas.
Le déconditionnement :
Pour que l’apprentissage disparaisse, il suffit de ne plus jamais renforcer le comportement, c’est la loi de l’extinction. Mais il est nécessaire de savoir que dès le début de la phase de déconditionnement, le comportement aura tendance à augmenter en fréquence.
La punition :
Une punition peut provoquer une réaction différente chez un chien, dépendant de son caractère, des relations avec son maitre, de la compréhension et de la sévérité de la punition, des expériences vécues, de son âge etc.
Toutes ces raisons font qu’une punition est souvent inutile, voire parfois néfaste.
Les auteurs incitent donc à respecter certaines règles concernant la punition :
– être appliquée systématiquement et sans délai après le comportement à corriger
– adaptée au chien (ni trop forte ni trop molle)
– être immédiatement stoppée lorsque le chien adopte une attitude de soumission
– ne jamais punir un chien qui est poussé dans un endroit où tout recul est impossible et qui menace (risque de morsure)
L’apaisement :
En tant que chef de meute, le maitre a un rôle à remplir suite à une punition, c’est à lui qu’incombe de « faire la paix » avec son animal. En effet, chez le chien le rituel d’agression comprend trois phases : la menace, la morsure, l’apaisement.
Les observations éthologiques montrent que c’est presque à chaque fois le vainqueur qui revient vers le vaincu et le lèche. cela se transpose au maitre qui reviendrait vers son chien pour lui parler gentiment et le caresser.
Je termine ces notes sur les mots suivants, extraits de la conclusion :
Les chiens ne sont pas muets […] ils disposent de nombreux moyens pour se faire comprendre par leurs congénères, mais aussi, […] pour communiquer avec une espèce différente. Les chiens sont en vérité des êtres de communication pure, puisque tout en eux véhicule un message.
Table des matières
- Préface
- Introduction
- Le chien, ses origines, son évolution
- Le chien dans nos foyers
- Que nous apporte le chien
- Le chien peut aussi poser des problèmes
- Le développement du chiot
- Les sens du chien
- La communication du chien
- L’organisation sociale des canidés.
- Qui est le chef ? l’homme ou le chien ?
- L’hérédité
- L’apprentissage
- Le rôle de l’acquis
- Un problème particulier: les morsures
- Le choix d’un chien
- L’arrivée du chiot à la maison
- Quelle attitude adopter face au chien ?
- Conclusion
- Bibliographie




Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.